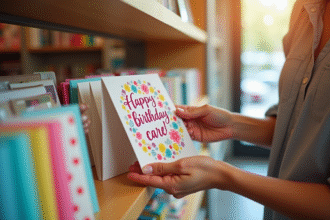Dire « beau » en français, c’est prendre parti. Pas de forme neutre, pas de solution toute faite : la grammaire impose son masculin, inflexible, même quand le groupe concerné ne se reconnaît dans aucune case. D’un côté, les guides d’écriture inclusive proposent des alternatives et appellent à une refonte nécessaire. De l’autre, les correcteurs automatiques et les dictionnaires refusent d’entériner ces usages. Le fossé entre norme et pratique s’élargit, tracté par les campagnes militantes et les premiers frémissements institutionnels.
Le mot « beau » à l’épreuve de l’égalité : pourquoi repenser nos compliments ?
Employer « beau », c’est adopter la règle du masculin générique, un héritage tenace qui confond neutralité et domination. Ce fait linguistique, loin d’être innocent, consolide une hiérarchie où le masculin écrase le reste. Derrière le compliment, un mécanisme bien rodé : la langue française révèle ses tensions, divisant là où elle pourrait rassembler. L’esthétique quotidienne, l’air de rien, devient un terrain de lutte pour celles et ceux qui refusent les stéréotypes sexistes.
À chaque fois qu’on félicite un groupe mixte ou qu’on s’adresse à une personne hors des catégories traditionnelles, la norme s’impose : le genre masculin gagne par défaut. Pourtant, la quête d’une égalité des genres se glisse jusque dans l’usage des adjectifs, révélant la force du langage sexiste qui façonne notre manière d’exister ensemble. Les discussions autour du français inclusif et de la justice sociale prennent ici une dimension tangible, portée par la volonté d’en finir avec la domination grammaticale.
Quelques réalités à considérer :
Pour mieux saisir l’enjeu, voici plusieurs points à garder en tête :
- Le masculin générique continue de dominer dans les manuels scolaires et les grammaires de référence.
- Les alternatives inclusives peinent à s’imposer dans les usages officiels et restent souvent limitées à certains milieux militants ou éditoriaux.
- Le choix des mots influence la façon dont femmes, hommes et personnes non-binaires sont perçus dans la société.
Le compliment, loin d’être anodin, traduit un système. « Beau » devient alors le symbole d’une vigilance à retrouver, d’une volonté de changer la langue pour mieux refléter la diversité et la justice sociale.
Écriture inclusive : quelles règles pour un adjectif plus universel ?
La langue française n’échappe plus à la remise en question. Face à l’enjeu du langage inclusif, de nouvelles pratiques voient le jour pour contrebalancer l’absence de neutre. L’écriture inclusive avance à tâtons, portée par des expérimentations variées, parfois critiquées, mais toujours révélatrices d’un besoin de justice symbolique.
Certains adjectifs, dits épicènes, s’utilisent sans distinction de genre : « superbe », « splendide », « magnifique ». Ils offrent une échappatoire, mais le français n’est pas toujours aussi accommodant. Pour des qualificatifs comme « beau », il faut innover. Voici plusieurs méthodes qui émergent :
- La double flexion : « beau et belle », « beaux et belles », une solution qui rend visible chaque identité, au prix d’une certaine lourdeur stylistique.
- L’utilisation du point médian : « beau·elle », « beaux·elles ». Prisée par une partie des adeptes du français inclusif, cette écriture fait débat, notamment chez les puristes et à l’Académie française.
- L’accord de proximité ou de majorité : choisir l’accord selon le mot le plus proche ou le genre prépondérant du groupe, comme le suggèrent plusieurs guides d’écriture inclusive.
D’autres voies sont explorées, comme la neutralisation des terminaisons ou la création de formes inédites. Des formules impersonnelles ou des néologismes apparaissent, cherchant à contourner la prescription grammaticale. La question de la féminisation s’étend, elle aussi, aux adjectifs, et si le consensus n’existe pas encore, la conversation progresse, portée par une dynamique collective.
Comment dire « beau » sans exclure : pistes et alternatives concrètes
Remettre en question l’usage de « beau » passe par une réflexion sur la structure même de l’éloge. Cet adjectif, qui porte une marque de genre à chaque emploi, met en lumière un déséquilibre historique. Pour contourner l’obstacle, plusieurs solutions concrètes s’offrent à celles et ceux qui souhaitent une communication inclusive respectueuse de toutes les identités.
On peut d’abord opter pour des adjectifs épicènes comme « magnifique », « admirable », « superbe ». Leur usage s’adapte sans effort au féminin, au masculin, aux identités non-binaires, et permet d’assurer une égalité de traitement. Lorsqu’aucun adjectif épicène ne convient, la réécriture propose une alternative : transformer l’adjectif en complément, comme « visage remarquable », « personne de beauté », « regard lumineux ».
La double flexion, « belles et beaux », s’impose dans de nombreux discours officiels ou contextes militants, insistant sur la présence de chaque identité. Pour les groupes mixtes ou non-binaires, certains suggèrent des formulations neutres : « tout le monde est splendide », « chacun·e est rayonnant·e ».
Rien n’empêche, enfin, d’imaginer de nouvelles formes ou d’oser la neutralisation pure et simple. Le français inclusif demeure un chantier vivant, à la croisée de l’innovation sociale et des libertés linguistiques.
Exemples inspirants pour enrichir sa communication inclusive au quotidien
À la croisée des pratiques et des idées
La communication inclusive s’expérimente déjà, portée par des initiatives concrètes et des réseaux qui réinventent la langue. Des collectifs comme Bye Bye Binary dessinent de nouveaux signes, bousculant la typographie traditionnelle. L’association AIME anime des ateliers où l’on s’entraîne à neutraliser les adjectifs et à privilégier des adjectifs épicènes, pour mieux échapper au masculin dominant.
Dans plusieurs domaines, les pratiques évoluent :
- En milieu scolaire, Hatier propose des manuels qui généralisent la double flexion et le point médian : « beaux·belles », « ami·e·s » font peu à peu leur chemin dans les salles de classe.
- La linguiste Julie Abbou invite à adopter des termes comme « magnifique », « remarquable » ou « éblouissant·e » dans les dialogues de tous les jours.
- Des médias tels que Le Café du FLE ou Slate offrent une tribune à Eliane Viennot et Gwenaëlle Perrier, qui analysent les fondements et les enjeux du langage inclusif.
Les recherches de Gaël Pasquier et Marie Loison-Leruste, relayées par le Haut Conseil à l’Égalité femmes-hommes, montrent à quel point la neutralisation linguistique modifie la perception de l’égalité. Même la circulaire Jean-Michel Blanquer, qui tente de freiner ces évolutions à l’école, n’a pas arrêté la créativité des professionnelles de la langue. Une nouvelle génération poursuit la transformation, jour après jour, pour façonner un français plus égalitaire.
Changer un adjectif, c’est parfois ouvrir une brèche dans l’histoire. La langue bouge, se débat, se réinvente. Et si le plus beau des compliments, demain, ne se décidait plus jamais au masculin ?